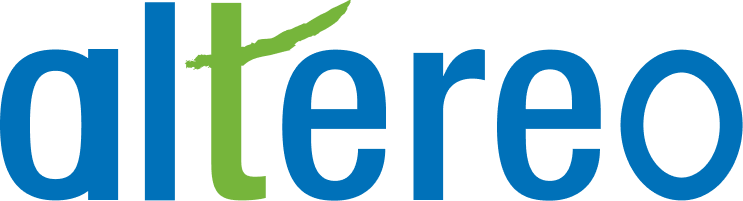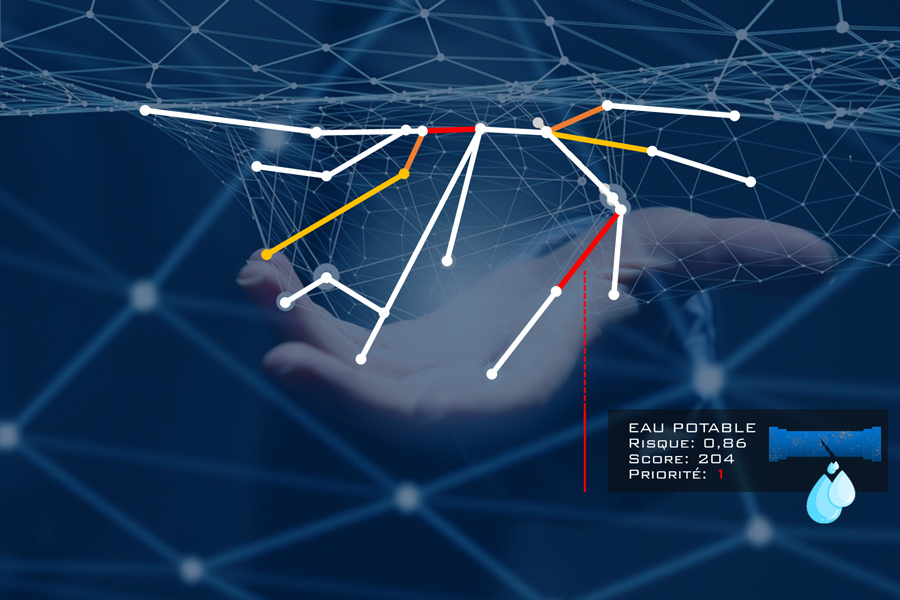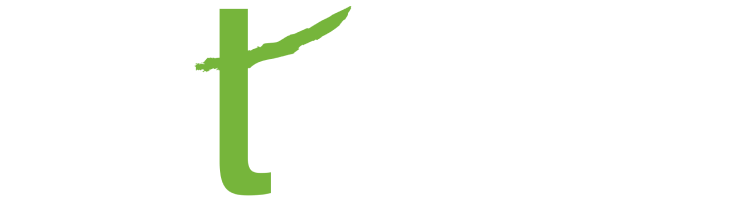Ingénierie : Altereo part à l’assaut des montagnes avec Hydrétudes
Les Échos
En faisant l'acquisition d'un expert en rivières d'altitude, l'entreprise spécialisée dans l'hydrologie urbaine se dote de nouvelles compétences en matière de prévention des risques.